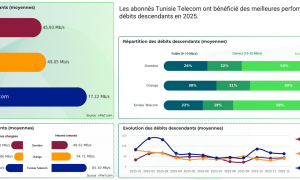Alors que l’intelligence artificielle générative s’installe dans notre quotidien, le Mobile Ecosystem Forum (MEF) publie une analyse signée par son PDG, Dario Betti. S’appuyant sur une étude d’OpenAI, il explore la manière dont ChatGPT s’intègre dans les usages professionnels, éducatifs et personnels, passant du statut de curiosité technologique à celui d’outil de travail indispensable.
Pendant des années, interroger Alexa faisait partie du quotidien. Mais tant que la version améliorée Alexa + n’est pas disponible partout, l’assistante vocale d’Amazon ressemble un peu à une star du cinéma muet à l’aube du parlant : une pionnière éclipsée par une génération plus expressive.
L’acteur principal de cette nouvelle ère s’appelle ChatGPT, le système d’IA générative le plus visible et le plus utilisé aujourd’hui. Jusqu’à récemment, on savait pourtant peu de choses sur ce que les gens en faisaient réellement.
La nouvelle étude d’OpenAI, How People Use ChatGPT, offre pour la première fois un aperçu détaillé de la façon dont l’outil s’intègre dans les routines professionnelles, éducatives et personnelles.
Une étude à interpréter avec prudence
Cette recherche repose sur des données anonymisées issues des utilisateurs de ChatGPT dans ses versions Free, Plus et Pro, analysées via un système respectueux de la vie privée qui examine de courts extraits de texte plutôt que des conversations entières. Cette méthode protège l’anonymat mais limite la profondeur d’interprétation : les chercheurs peuvent identifier des tendances sans en connaître le contexte complet ni les motivations.
L’échantillon reste également biaisé vers les régions anglophones à revenu élevé, une photographie d’adopteurs précoces plutôt qu’un reflet mondialement représentatif. Malgré ces limites, le rapport fournit la vue la plus claire à ce jour de la manière dont l’IA générative s’ancre dans nos vies, passant du statut de curiosité à celui d’utilité essentielle.
De l’expérimentation à l’intégration
Au début, ChatGPT était utilisé sur un mode ludique : tester ses limites, poser des questions insolites, explorer ses bizarreries. Cette phase d’exploration a depuis cédé la place à une utilisation plus ciblée. Dans de nombreux métiers, ChatGPT agit désormais comme un amplificateur du travail humain, non comme un substitut.
Les utilisateurs automatisent rarement une tâche complète ; ils s’en servent plutôt pour accélérer la rédaction, la synthèse, la reformulation ou la correction de code, autrement dit, pour alléger le travail fastidieux. Cela pourrait redéfinir la productivité : à mesure que l’IA prend en charge la routine, elle élargit la capacité du travail humain. Les attentes en matière de rendement pourraient donc augmenter, car il devient possible de produire davantage en moins de temps.
Des usages professionnels bien distincts
Le rapport identifie deux grands pôles d’utilisation. Les utilisateurs techniques (développeurs, analystes, ingénieurs) se servent de ChatGPT pour dépanner, rédiger du code ou expliquer des concepts complexes. Les professionnels créatifs et les enseignants, eux, l’emploient pour générer des idées, rédiger ou affiner leurs communications.
Mais ces frontières s’estompent : les créatifs utilisent l’IA pour l’analyse structurée, tandis que les techniciens explorent ses capacités conceptuelles et narratives. Cette flexibilité favorise une pollinisation croisée des compétences, brouillant les distinctions entre technique et créativité.
L’éducation comme terrain d’expérimentation
C’est dans le secteur de l’éducation que cette hybridation se manifeste le plus. Les étudiants utilisent ChatGPT pour résumer leurs lectures, clarifier des notions complexes ou rédiger des brouillons, tandis que les enseignants s’en servent pour concevoir des cours ou créer des examens. Malgré les inquiétudes persistantes concernant l’intégrité académique, l’attitude générale reste pragmatique : enseignants et apprenants voient ChatGPT comme un collaborateur, non comme un raccourci, et vérifient systématiquement les résultats.
L’IA devient ainsi un tuteur, un éditeur et un assistant de recherche réunis en un seul outil. L’éducation pourrait bien être le banc d’essai d’une évolution plus large : un monde où l’IA est censée assister plutôt qu’automatiser.
Une adoption prudente dans la santé
Le rapport indique que le secteur de la santé reste un utilisateur modeste de ChatGPT. Les cliniciens et chercheurs testent cependant des cas d’usage comme la synthèse des notes médicales, la vulgarisation des diagnostics pour les patients ou la réduction de la charge administrative.
Ces expérimentations restent limitées mais montrent que l’IA générative peut d’abord gagner la confiance par des rôles d’assistance à faible risque avant d’aborder des usages plus complexes.
Des différences générationnelles et sectorielles
L’adoption varie selon l’âge et le secteur. Les professionnels de la technologie, des sciences et du business sont les premiers utilisateurs, tandis que les secteurs de services et manuels adoptent plus lentement.
Les jeunes, étudiants et jeunes actifs, intègrent ChatGPT naturellement dans leur flux de travail, alors que les générations plus âgées l’utilisent de manière plus ciblée pour gagner en productivité. Ces différences laissent penser qu’à mesure que les natifs du numérique avancent dans leur carrière, la maîtrise de l’IA deviendra un prérequis implicite.
Un tournant prudent mais significatif
Les auteurs de How People Use ChatGPT reconnaissent les limites de leur étude. Elle offre une vue d’ensemble à grande échelle, pas une cartographie définitive de l’avenir. Mais même ainsi, les conclusions sont marquantes : l’IA générative n’est plus une nouveauté, c’est une nécessité. Dans les salles de classe, les hôpitaux ou les bureaux, ChatGPT transforme non seulement la vitesse du travail humain, mais aussi sa texture : la manière dont les idées naissent, se forment et se diffusent.
Le rapport marque peut-être un tournant culturel : l’ère du cinéma muet de l’IA, celle des assistants scriptés à commandes figées, cède la place à une intelligence plus conversationnelle, réactive et créative.
Dario Betti
CEO, Mobile Ecosystem Forum (MEF)
À propos de l’auteur
Dario Betti est PDG du Mobile Ecosystem Forum (MEF), organisation mondiale fondée en 2000 et basée au Royaume-Uni, regroupant des membres du monde entier.
Le MEF agit comme la voix du secteur mobile, promouvant les bonnes pratiques, la lutte contre la fraude et la monétisation. À l’approche de son 25e anniversaire en 2025, le Forum continue d’offrir à ses membres des plateformes mondiales et intersectorielles pour le réseautage, la collaboration et l’avancement de solutions communes.